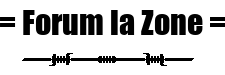Anna était déterminée.
Il y a eu beaucoup de versions, évidemment. Certaines écrites à la va-vite sur des serviettes de bar, d'autres dictées par des gens qui entendaient des voix dans les radiateurs. Le récit n'a jamais tenu droit : il penche, il trébuche, il change de timbre comme un poste de radio qu'on secoue. Personne n'a vraiment su qui parlait, ou qui croyait parler, ou si tout ça n'était qu'un seul cerveau fendu en quatre. Mais ce n'est pas grave : dans ce type d'histoire, il faut accepter que la narration se contamine elle-même, comme une fièvre qui s'empare du texte et déplace les bouches d'une phrase à l'autre. Alors oui : Anna était déterminée — du moins, c'est ce qu'affirme la première voix. Les autres suivront comme elles peuvent.
Et déterminé, il faut l'être, pour le découper comme ça, sans s'énerver, sans se louper, sans dévisser, avec passion mais non sans patience, petits bouts par petits bouts, presque même, il faut le dire, avec une sorte de tendresse, bien naturelle ceci dit vu la tonne d'amour qu'elle lui avait donné, et qu'il ne lui avait jamais vraiment rendu.
Donc avec aussi une douceur, mais assez de nerf pour le trancher, assez de force pour casser les parties les plus solides, écarter sans trembler les morceaux contrevenants à la beauté du geste, dégorger sans ciller les bouts tremblants qui lui firent, sur le coup, penser à la gelée de groseille que confectionnait, en été, mamie Zelie, à l'odeur des kilos de sucre qu'elle y mélangeait. A l'odeur du soleil, à l'odeur des plantes bizarres qu'il ne faut pas toucher, à l'odeur d'essence dans la vieille grange, ou à celle d'œuf pourri dans les recoins du canapé.
Avec retenue, bien sûr, car il ne faut jamais rien oublier, ni le bien, ni le maaaaaaaal. Elle se mit à fredonner, tout en malaxant les parties les plus tendres, en les tournant et les retournant, sans jamais se lasser ; ses doigts devenus des bouches, des nez, des sexes, qui absorbaient, transportaient, exacerbaient chaque sensation, le chaud comme le froid, le sec comme l'humide. Et tout en chantonnant elle se souvenait, la pauvre, de la manière stupide, horrible et déprimante, dont tout avait commencé.
Tout avait commencé par un éclat d'écran, un soir d'hiver où la neige tapissait les trottoirs de Paris comme un linceul immaculé, et Anna, blottie sous une couverture usée, avait découvert Philippe Croizon, cet homme-tronc aux épaules d'acier forgé dans l'adversité, dont les vagues de la Manche s'étaient brisées contre la volonté farouche. Ses exploits n'étaient pas des trophées vulgaires, mais des poèmes gravés dans l'écume salée : traverser l'océan Indien à la nage, quatre mille kilomètres de sel et de rage, sans bras ni jambes pour s'accrocher aux courants, seulement ce torse sculpté par la perte, ce cœur qui battait comme un tambour de guerre contre les abysses. Anna l'avait aimé d'abord pour cette absence sublime, ces moignons arrondis comme des racines d'arbre centenaire, vestiges d'un accident qui l'avait dépouillé mais révélé, un corps réduit à l'essentiel, un vaisseau sans voiles naviguant sur la mer des impossibles. Elle imaginait ses nuits à lui, bercées par le ressac des souvenirs, et les siennes s'en trouvaient hantées : elle, aux doigts agiles de couturière, rêvait de caresser ces contours tronqués, de les habiller de tendresse comme on rhabille une statue antique de marbre ébréché.
Philippe, avec ses traversées de détroits – le canal de Suez, la mer Rouge, chaque bras d'eau un défi lancé au destin –, incarnait pour elle l'amour pur, celui qui n'a pas besoin de membres pour enlacer, mais d'une âme qui palpite au rythme des marées indomptables. Elle collectionnait ses interviews comme des reliquaires, relisant ses mots sur la douleur transmutée en triomphe, et dans le silence de son appartement aux murs tapissés de cartes marines, Anna sentait son propre corps s'alourdir d'un désir inédit, viscéral, pour cet homme qui avait dompté les océans sans jamais plier. Cet amour naquit donc en elle comme une marée montante, irrésistible, emportant ses doutes passés dans un tourbillon d'admiration ; elle le voyait en rêve, flottant nu sur les flots, son torse luisant sous le soleil tropical, et elle se réveillait les cuisses humides de cette ferveur océanique. Mais les marées, hélas, ont leurs reflux, et l'amour d'Anna pour Philippe commença à se teinter de sel amer, quand les nouvelles de ses exploits se firent plus rares, remplacées par des silences radio, des absences qui creusaient en elle un vide aussi vaste que les mers qu'il avait conquises.
Petit à petit, la tendresse vira à l'obsession, un poison sucré qui s'infiltra dans ses veines : elle scrutait les forums obscurs pour des bribes de sa vie privée, imaginant ses amours charnels impossibles, et une jalousie acide lui rongeait les entrailles, transformant l'héroïsme en monopole possessif. L'amour devint toxique comme une algue vénéneuse, étouffant ses propres aspirations – Anna abandonna ses toiles inachevées pour des nuits blanches à guetter son ombre sur les réseaux, son corps à elle se fanant en parallèle, pâle et flasque, tandis que le sien, mythique, enflait en idole intouchable. Bientôt, les exploits de Philippe, jadis phares dans sa nuit, se muèrent en reproches muets : pourquoi n'était-il pas à elle, ce torse invincible, pourquoi sa liberté aquatique la condamnait-elle à une immobilité terrestre, enchaînée à un désir qui la rongeait comme une marée noire sur une plage sacrée ? La toxicité s'épanouit en une dépendance funeste, où chaque vague de doute la submergeait, et Anna, les yeux rougis par des larmes salées, se surprit à haïr les eaux qui l'avaient vu triompher, ces mers complices qui le gardaient loin d'elle, prisonnière d'un amour qui puait le varech pourri.
C'est alors que l'image surgit, fulgurante, dans l'un de ces délires fiévreux : Philippe, non plus nageur des abysses, mais une grosse pomme de terre noueuse, terreuse, blottie dans la terre meuble de son admiration, sa peau rugueuse et bosselée évoquant ces moignons qu'elle avait tant chéris, un tubercule gorgé de promesses pourries. Mentalement, elle le dépouilla déjà : cette pomme de terre massive, Philippe en son cœur charnu et fade, nourrie de ses propres sèves amoureuses, mais refusant de germer pour elle, de s'épanouir en une fleur vénéneuse qu'elle seule aurait pu cueillir. L'identification s'opéra dans un frisson de révélation malsaine, où l'amour toxique se cristallisa en cette métaphore organique : il était cette racine enflée, immobile et insatiable, absorbant toute lumière sans rien rendre, un légume difforme qu'il fallait éplucher pour en extraire la moelle, la vérité amère cachée sous l'écorce. Anna, les mains tremblantes d'une excitation nouvelle, fouilla les recoins de sa mémoire pour des outils ancestraux, mais c'est dans un catalogue veterinaires abandonné qu'elle trouva l'instrument divin : une seringue hypodermique pour éléphants, arme démesurée au dard acéré, capable d'injecter l'amour sous la peau la plus épaisse.
La décision mûrit comme une nuit sans lune, dans le silence de sa baignoire ébréchée, où elle imaginait déjà le rituel : l'attaque par surprise, un soir de crachin parisien, quand Philippe, confiant en sa gloire, franchirait le seuil de son antre, ignorant qu'il y entrerait pour la dernière fois en homme-tronc, mais en tubercule prêt à être pelé. Avec une tendresse perverse, elle prépara le bain, versant des huiles essentielles qui embaumaient la pièce d'un parfum de terre humide et de sucre brûlé, mélange alchimique pour adoucir l'épluchage, car cet acte serait un amour ultime, une dissection amoureuse où chaque lambeau de peau arraché révélerait les strates de leur passion empoisonnée. Et lorsque l'aiguille transpercerait la chair, non pour tuer mais pour libérer – une injection de sédatif doux, suivi du scalpel imaginaire de ses ongles –, Anna fredonnerait à nouveau, les yeux mi-clos, tandis que Philippe, flottant inerte dans l'eau tiède, se muait en pomme de terre émondée, sa chair pâle et vulnérable offerte à sa dévotion finale. Ainsi, dans cette baignoire devenue autel païen, l'amour toxique s'accomplirait en un geste suprême, épluchant non seulement la peau mais l'âme, jusqu'à ce que ne reste, au fond de l'eau rougie de souvenirs, le noyau pur et nu d'un homme enfin rendu à elle, pour toujours, dans la tendresse d'un tubercule dénudé.
Il faudrait préciser qu'à partir d'ici, plus personne ne sait exactement qui raconte. Les témoignages retrouvés sont couverts de ratures, de griffures, de phrases écrites dans des encres différentes. Certains fragments semblent provenir d'Anna, d'autres d'un observateur qui n'a jamais existé, et quelques paragraphes paraissent dictés par un esprit goguenard qui n'a aucun lien avec l'affaire. Les enquêteurs ont parlé d'une "pollinisation narrative", un phénomène rare où les voix se fécondent mutuellement jusqu'à produire un récit mutant, ingérable, proliférant. Le texte change donc de gorge, de souffle, de conscience — sans prévenir. C'est normal. C'est la seule manière que cette histoire a trouvée pour continuer à exister.
Philippe ne put s'empêcher de traîner là encore un bon moment se délectant du changement de couleur de son épiderme. La dépouille de Anna s'affaissait de plus en plus, mais il ne voulait pas la laisser couler sous la surface de l'eau du bain. Il la retint de ses pieds pour lui permettre de continuer à contempler son visage si beau, si extatique à l'image de sainte Thérèse. Il resta là au moins une heure avant de s'en lasser et finit par sortir du bain tout empourpré. Dégoulinant d'hémoglobine, il la contempla encore quelques minutes. Cette dépouille que n'emporterait pas Charon dans sa barque à travers le Styx, ne provoquait chez lui aucune émotion. C'était loin d'être la première et pourtant il s'attendait toujours à un miracle. Lequel ? Il ne le savait pas lui-même. Tandis que l'eau rougie commençait à déborder de la vasque, pénétrant le plancher jusqu'à traverser le plafond chez le voisin du dessous, il se dit qu'il était temps pour lui de mettre les voiles. Il s'épongea à toute vitesse et enfila ses vêtements. Puis, il sortit de l'appartement comme il était venu tel un indésirable voyeur. Comme à son habitude, il s'effaça dans la foule de la rue, ne cessant de contempler son trophée : un petit bracelet qu'il avait prélevé au poignet de sa victime. Quelques heures plus tard, l'inondation ayant fait ses effets, le voisin du dessous commença à s'inquiéter et alla alerter la concierge. Le tandem courut dans les escaliers et la bonne femme ouvrit avec son passe la porte d'Anna. En découvrant le cadavre, à peine visible sous l'hémoglobine, la femme se mit à hurler tandis que le voisin restait muet la bouche grande ouverte. Il leur fallut quelques minutes pour sortir de leur trauma et appeler la police. On imagine facilement la suite de la scène du crime remplie à ras bord d'uniformes et d'un inspecteur. Principal en charge, un certain lieutenant du nom de Albert Cresson, n'eut pas de réaction tangible. Car c'était la 3e victime du même genre qu'il rencontrait en quelques semaines. On déboucha la baignoire pour découvrir le corps inerte que la brigade scientifique s'empressa d'examiner ; ils ne trouvèrent aucune trace visible de la moindre agression. Alors ?
Plus tard, on rassemblera toutes les versions dans une boîte en carton humide, et personne ne saura trancher laquelle était la vraie. Les voix continueront de se répondre à travers le papier, comme si chacune refusait de mourir seule. Les experts parleront de dissociation, les médiums d'infiltration spectrale, les psy de psychose partagée. Aucun n'aura raison, ou peut-être qu'ils auront tous raison en même temps. Le dossier sentira la moisissure, la mer et le sucre brûlé. Et chaque fois qu'on l'ouvrira, on entendra un chuchotement différent, comme si le texte tentait encore de se réécrire lui-même pour retrouver une cohérence qui ne viendra jamais. Après tout, certaines histoires ne veulent pas être racontées : elles préfèrent se raconter toutes seules, d'une voix à l'autre, d'un cadavre à l'exquis suivant.
L'eau débordait lentement, inondant la salle de bain et emportant avec elle, toute la crasse de ce monde.
Il y a eu beaucoup de versions, évidemment. Certaines écrites à la va-vite sur des serviettes de bar, d'autres dictées par des gens qui entendaient des voix dans les radiateurs. Le récit n'a jamais tenu droit : il penche, il trébuche, il change de timbre comme un poste de radio qu'on secoue. Personne n'a vraiment su qui parlait, ou qui croyait parler, ou si tout ça n'était qu'un seul cerveau fendu en quatre. Mais ce n'est pas grave : dans ce type d'histoire, il faut accepter que la narration se contamine elle-même, comme une fièvre qui s'empare du texte et déplace les bouches d'une phrase à l'autre. Alors oui : Anna était déterminée — du moins, c'est ce qu'affirme la première voix. Les autres suivront comme elles peuvent.
Et déterminé, il faut l'être, pour le découper comme ça, sans s'énerver, sans se louper, sans dévisser, avec passion mais non sans patience, petits bouts par petits bouts, presque même, il faut le dire, avec une sorte de tendresse, bien naturelle ceci dit vu la tonne d'amour qu'elle lui avait donné, et qu'il ne lui avait jamais vraiment rendu.
Donc avec aussi une douceur, mais assez de nerf pour le trancher, assez de force pour casser les parties les plus solides, écarter sans trembler les morceaux contrevenants à la beauté du geste, dégorger sans ciller les bouts tremblants qui lui firent, sur le coup, penser à la gelée de groseille que confectionnait, en été, mamie Zelie, à l'odeur des kilos de sucre qu'elle y mélangeait. A l'odeur du soleil, à l'odeur des plantes bizarres qu'il ne faut pas toucher, à l'odeur d'essence dans la vieille grange, ou à celle d'œuf pourri dans les recoins du canapé.
Avec retenue, bien sûr, car il ne faut jamais rien oublier, ni le bien, ni le maaaaaaaal. Elle se mit à fredonner, tout en malaxant les parties les plus tendres, en les tournant et les retournant, sans jamais se lasser ; ses doigts devenus des bouches, des nez, des sexes, qui absorbaient, transportaient, exacerbaient chaque sensation, le chaud comme le froid, le sec comme l'humide. Et tout en chantonnant elle se souvenait, la pauvre, de la manière stupide, horrible et déprimante, dont tout avait commencé.
Tout avait commencé par un éclat d'écran, un soir d'hiver où la neige tapissait les trottoirs de Paris comme un linceul immaculé, et Anna, blottie sous une couverture usée, avait découvert Philippe Croizon, cet homme-tronc aux épaules d'acier forgé dans l'adversité, dont les vagues de la Manche s'étaient brisées contre la volonté farouche. Ses exploits n'étaient pas des trophées vulgaires, mais des poèmes gravés dans l'écume salée : traverser l'océan Indien à la nage, quatre mille kilomètres de sel et de rage, sans bras ni jambes pour s'accrocher aux courants, seulement ce torse sculpté par la perte, ce cœur qui battait comme un tambour de guerre contre les abysses. Anna l'avait aimé d'abord pour cette absence sublime, ces moignons arrondis comme des racines d'arbre centenaire, vestiges d'un accident qui l'avait dépouillé mais révélé, un corps réduit à l'essentiel, un vaisseau sans voiles naviguant sur la mer des impossibles. Elle imaginait ses nuits à lui, bercées par le ressac des souvenirs, et les siennes s'en trouvaient hantées : elle, aux doigts agiles de couturière, rêvait de caresser ces contours tronqués, de les habiller de tendresse comme on rhabille une statue antique de marbre ébréché.
Philippe, avec ses traversées de détroits – le canal de Suez, la mer Rouge, chaque bras d'eau un défi lancé au destin –, incarnait pour elle l'amour pur, celui qui n'a pas besoin de membres pour enlacer, mais d'une âme qui palpite au rythme des marées indomptables. Elle collectionnait ses interviews comme des reliquaires, relisant ses mots sur la douleur transmutée en triomphe, et dans le silence de son appartement aux murs tapissés de cartes marines, Anna sentait son propre corps s'alourdir d'un désir inédit, viscéral, pour cet homme qui avait dompté les océans sans jamais plier. Cet amour naquit donc en elle comme une marée montante, irrésistible, emportant ses doutes passés dans un tourbillon d'admiration ; elle le voyait en rêve, flottant nu sur les flots, son torse luisant sous le soleil tropical, et elle se réveillait les cuisses humides de cette ferveur océanique. Mais les marées, hélas, ont leurs reflux, et l'amour d'Anna pour Philippe commença à se teinter de sel amer, quand les nouvelles de ses exploits se firent plus rares, remplacées par des silences radio, des absences qui creusaient en elle un vide aussi vaste que les mers qu'il avait conquises.
Petit à petit, la tendresse vira à l'obsession, un poison sucré qui s'infiltra dans ses veines : elle scrutait les forums obscurs pour des bribes de sa vie privée, imaginant ses amours charnels impossibles, et une jalousie acide lui rongeait les entrailles, transformant l'héroïsme en monopole possessif. L'amour devint toxique comme une algue vénéneuse, étouffant ses propres aspirations – Anna abandonna ses toiles inachevées pour des nuits blanches à guetter son ombre sur les réseaux, son corps à elle se fanant en parallèle, pâle et flasque, tandis que le sien, mythique, enflait en idole intouchable. Bientôt, les exploits de Philippe, jadis phares dans sa nuit, se muèrent en reproches muets : pourquoi n'était-il pas à elle, ce torse invincible, pourquoi sa liberté aquatique la condamnait-elle à une immobilité terrestre, enchaînée à un désir qui la rongeait comme une marée noire sur une plage sacrée ? La toxicité s'épanouit en une dépendance funeste, où chaque vague de doute la submergeait, et Anna, les yeux rougis par des larmes salées, se surprit à haïr les eaux qui l'avaient vu triompher, ces mers complices qui le gardaient loin d'elle, prisonnière d'un amour qui puait le varech pourri.
C'est alors que l'image surgit, fulgurante, dans l'un de ces délires fiévreux : Philippe, non plus nageur des abysses, mais une grosse pomme de terre noueuse, terreuse, blottie dans la terre meuble de son admiration, sa peau rugueuse et bosselée évoquant ces moignons qu'elle avait tant chéris, un tubercule gorgé de promesses pourries. Mentalement, elle le dépouilla déjà : cette pomme de terre massive, Philippe en son cœur charnu et fade, nourrie de ses propres sèves amoureuses, mais refusant de germer pour elle, de s'épanouir en une fleur vénéneuse qu'elle seule aurait pu cueillir. L'identification s'opéra dans un frisson de révélation malsaine, où l'amour toxique se cristallisa en cette métaphore organique : il était cette racine enflée, immobile et insatiable, absorbant toute lumière sans rien rendre, un légume difforme qu'il fallait éplucher pour en extraire la moelle, la vérité amère cachée sous l'écorce. Anna, les mains tremblantes d'une excitation nouvelle, fouilla les recoins de sa mémoire pour des outils ancestraux, mais c'est dans un catalogue veterinaires abandonné qu'elle trouva l'instrument divin : une seringue hypodermique pour éléphants, arme démesurée au dard acéré, capable d'injecter l'amour sous la peau la plus épaisse.
La décision mûrit comme une nuit sans lune, dans le silence de sa baignoire ébréchée, où elle imaginait déjà le rituel : l'attaque par surprise, un soir de crachin parisien, quand Philippe, confiant en sa gloire, franchirait le seuil de son antre, ignorant qu'il y entrerait pour la dernière fois en homme-tronc, mais en tubercule prêt à être pelé. Avec une tendresse perverse, elle prépara le bain, versant des huiles essentielles qui embaumaient la pièce d'un parfum de terre humide et de sucre brûlé, mélange alchimique pour adoucir l'épluchage, car cet acte serait un amour ultime, une dissection amoureuse où chaque lambeau de peau arraché révélerait les strates de leur passion empoisonnée. Et lorsque l'aiguille transpercerait la chair, non pour tuer mais pour libérer – une injection de sédatif doux, suivi du scalpel imaginaire de ses ongles –, Anna fredonnerait à nouveau, les yeux mi-clos, tandis que Philippe, flottant inerte dans l'eau tiède, se muait en pomme de terre émondée, sa chair pâle et vulnérable offerte à sa dévotion finale. Ainsi, dans cette baignoire devenue autel païen, l'amour toxique s'accomplirait en un geste suprême, épluchant non seulement la peau mais l'âme, jusqu'à ce que ne reste, au fond de l'eau rougie de souvenirs, le noyau pur et nu d'un homme enfin rendu à elle, pour toujours, dans la tendresse d'un tubercule dénudé.
Il faudrait préciser qu'à partir d'ici, plus personne ne sait exactement qui raconte. Les témoignages retrouvés sont couverts de ratures, de griffures, de phrases écrites dans des encres différentes. Certains fragments semblent provenir d'Anna, d'autres d'un observateur qui n'a jamais existé, et quelques paragraphes paraissent dictés par un esprit goguenard qui n'a aucun lien avec l'affaire. Les enquêteurs ont parlé d'une "pollinisation narrative", un phénomène rare où les voix se fécondent mutuellement jusqu'à produire un récit mutant, ingérable, proliférant. Le texte change donc de gorge, de souffle, de conscience — sans prévenir. C'est normal. C'est la seule manière que cette histoire a trouvée pour continuer à exister.
Philippe ne put s'empêcher de traîner là encore un bon moment se délectant du changement de couleur de son épiderme. La dépouille de Anna s'affaissait de plus en plus, mais il ne voulait pas la laisser couler sous la surface de l'eau du bain. Il la retint de ses pieds pour lui permettre de continuer à contempler son visage si beau, si extatique à l'image de sainte Thérèse. Il resta là au moins une heure avant de s'en lasser et finit par sortir du bain tout empourpré. Dégoulinant d'hémoglobine, il la contempla encore quelques minutes. Cette dépouille que n'emporterait pas Charon dans sa barque à travers le Styx, ne provoquait chez lui aucune émotion. C'était loin d'être la première et pourtant il s'attendait toujours à un miracle. Lequel ? Il ne le savait pas lui-même. Tandis que l'eau rougie commençait à déborder de la vasque, pénétrant le plancher jusqu'à traverser le plafond chez le voisin du dessous, il se dit qu'il était temps pour lui de mettre les voiles. Il s'épongea à toute vitesse et enfila ses vêtements. Puis, il sortit de l'appartement comme il était venu tel un indésirable voyeur. Comme à son habitude, il s'effaça dans la foule de la rue, ne cessant de contempler son trophée : un petit bracelet qu'il avait prélevé au poignet de sa victime. Quelques heures plus tard, l'inondation ayant fait ses effets, le voisin du dessous commença à s'inquiéter et alla alerter la concierge. Le tandem courut dans les escaliers et la bonne femme ouvrit avec son passe la porte d'Anna. En découvrant le cadavre, à peine visible sous l'hémoglobine, la femme se mit à hurler tandis que le voisin restait muet la bouche grande ouverte. Il leur fallut quelques minutes pour sortir de leur trauma et appeler la police. On imagine facilement la suite de la scène du crime remplie à ras bord d'uniformes et d'un inspecteur. Principal en charge, un certain lieutenant du nom de Albert Cresson, n'eut pas de réaction tangible. Car c'était la 3e victime du même genre qu'il rencontrait en quelques semaines. On déboucha la baignoire pour découvrir le corps inerte que la brigade scientifique s'empressa d'examiner ; ils ne trouvèrent aucune trace visible de la moindre agression. Alors ?
Plus tard, on rassemblera toutes les versions dans une boîte en carton humide, et personne ne saura trancher laquelle était la vraie. Les voix continueront de se répondre à travers le papier, comme si chacune refusait de mourir seule. Les experts parleront de dissociation, les médiums d'infiltration spectrale, les psy de psychose partagée. Aucun n'aura raison, ou peut-être qu'ils auront tous raison en même temps. Le dossier sentira la moisissure, la mer et le sucre brûlé. Et chaque fois qu'on l'ouvrira, on entendra un chuchotement différent, comme si le texte tentait encore de se réécrire lui-même pour retrouver une cohérence qui ne viendra jamais. Après tout, certaines histoires ne veulent pas être racontées : elles préfèrent se raconter toutes seules, d'une voix à l'autre, d'un cadavre à l'exquis suivant.
L'eau débordait lentement, inondant la salle de bain et emportant avec elle, toute la crasse de ce monde.